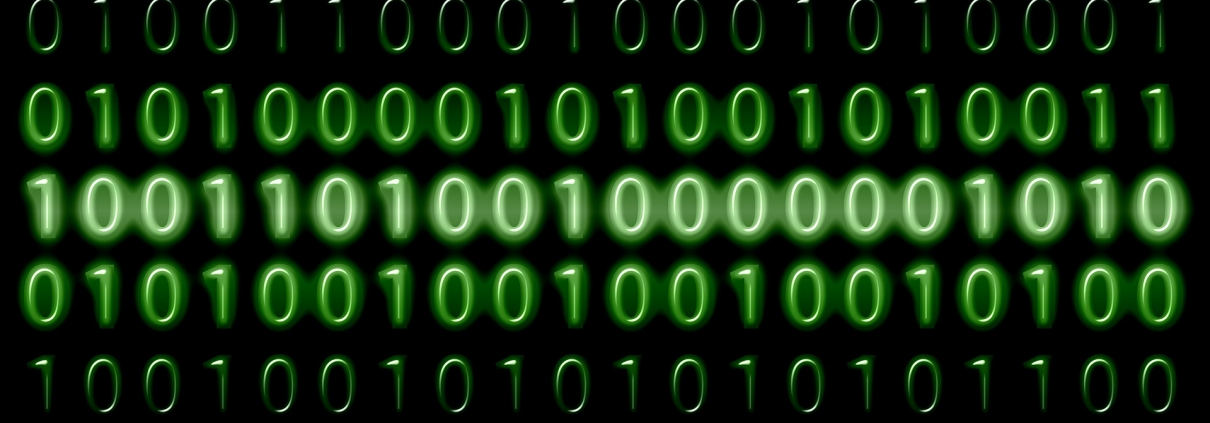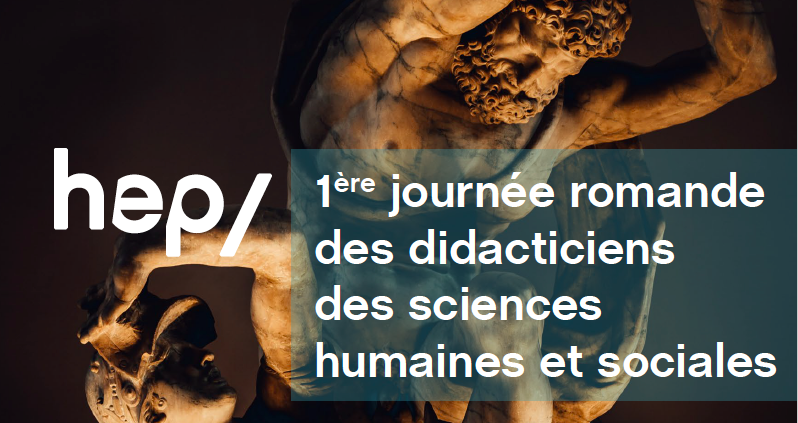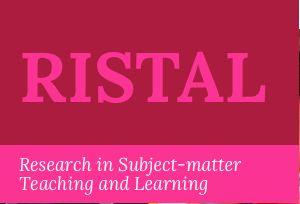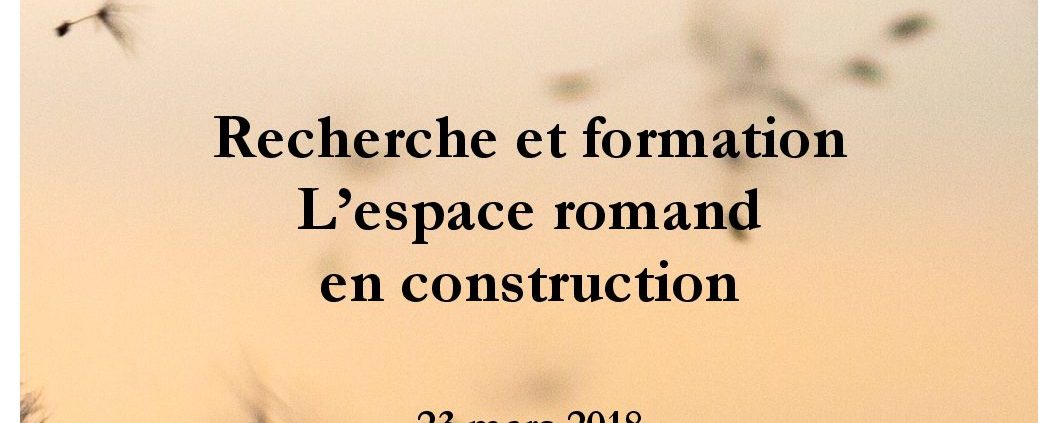Des transformations importantes sont en cours en ce qui concerne la présence de l’informatique à l’école dans de nombreuses régions du monde, et particulièrement en Suisse.
Alors qu’aujourd’hui encore l’informatique est souvent confondue avec l’apprentissage des usages d’outils numériques, des attentes récurrentes ont été exprimées récemment dans la société et relayées dans les médias pour apporter aux élèves non seulement des compétences d’utilisateur, mais également une compréhension des phénomènes sous-jacents au fonctionnement des technologies. Ces fondements conceptuels sont au cœur de la science informatique, la science qui explique les mécanismes propres au monde virtuel de l’information.
Ce mouvement se concrétise de plusieurs manières en Suisse.
Enseignement post-obligatoire
En ce qui concerne l’enseignement post-obligatoire, la Conférence intercantonale des directeurs de l’instruction publique (CDIP) a voté le 27 octobre 2017 une révision du Règlement de reconnaissance des maturités dans laquelle l’informatique est ajoutée en tant que discipline obligatoire pour l’ensemble des élèves de l’école de maturité (http://www.edk.ch/dyn/30966.php). En termes de contenus, le plan d’études cadre proposé par la CDIP porte clairement sur la science informatique (principes de base du traitement automatique de l’information, représentation de l’information, aspects techniques des réseaux informatiques…) et exclut l’apprentissage de l’utilisation de logiciels.
Cette décision va permettre à l’ensemble des élèves de l’école de maturité de bénéficier d’un enseignement des bases de la science informatique. Les cantons ont jusqu’à 2022 pour mettre en œuvre cette décision. Par souci d’équité, il serait évidemment bienvenu qu’un tel changement ne se cantonne pas qu’aux élèves de l’école de maturité, mais puisse également s’étendre à l’avenir aux élèves de l’école de culture générale qui ont tout autant besoin pour leur culture générale de ces connaissances.
À noter que dans ce cadre, un effort particulier est fourni pour la formation des enseignants d’informatique: de nombreux enseignants seront en effet nécessaires pour donner ces cours et ils doivent disposer d’une formation de niveau master dans la discipline. Les universités, écoles polytechniques, hautes écoles spécialisées et pédagogiques suisses, à l’instigation de Swissuniversities, mettent donc sur pied un programme coordonné de formation pour des enseignants de gymnase qui souhaiteraient ajouter l’enseignement de l’informatique à leur bagage. Toutes les informations sont disponibles ici: https://www3.unifr.ch/gyminf/fr/.
Enseignement obligatoire
Pour ce qui est de l’école obligatoire, la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse Romande et du Tessin (CIIP) a décidé le 22 novembre 2018 l’adoption d’un plan d’action et le lancement des travaux de coopération en faveur de l’éducation numérique dans l’espace latin de la formation (http://www.ciip.ch/files/2/CIIP_Decision_Plan-action-numerique_2018-11-22.pdf).
Parmi les cinq priorités formulées dans ce plan, la première portant sur les plans d’études mentionne que:
l’éducation numérique, incluant la science informatique, le développement des compétences d’utilisateur actif des outils numériques, ainsi que l’éducation aux médias, est introduite pour tous les élèves, apprenants et étudiants, dans la scolarité obligatoire comme dans toutes les filières du degré post-obligatoire. (p. 2)
Alors que jusque-là seuls les MITIC existaient dans le Plan d’études romand, comme un élément transversal comprenant les usages d’outils numériques et l’éducation aux médias, la science informatique est cette fois clairement mentionnée.
En termes d’actions, le document de la CIIP mentionne la nécessité d’«inscrire la science informatique en tant que discipline proprement dite dans l’enseignement des trois cycles» (p. 2), tout en étendant les usages d’outils numériques et renforçant l’éducation aux médias.
Cette décision étant très récente, les travaux de la CIIP démarrent seulement, il sera intéressant de voir comment cela se concrétise à l’avenir. Certains cantons — comme le canton de Vaud — n’ont pas attendu cette décision et ont déjà lancé leurs propres projets d’éducation numérique.
Ces évènements semblent bien montrer que l’on assiste avec l’informatique à l’émergence d’une nouvelle discipline scolaire.
Gabriel Parriaux, HEP Vaud, didactique romande d’informatique (gabriel.parriaux@hepl.ch)