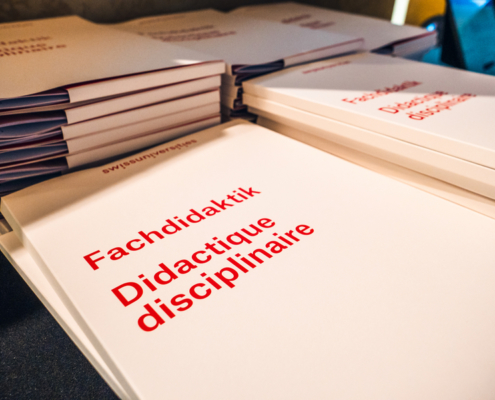18-19 avril 2024, Haute Ecole Pédagogique de Thurgovie (Kreuzlingen)
Didacticien·nes romand·es et alémaniques se sont retrouvé·es les 18 et 19 avril derniers pour une exploration commune des défis et avancées du champ dans ses différents domaines, en dialogue avec les ambitions de la stratégie fédérale qui lui est consacrée.
Parmi les objets de débat :
- la nécessité d’une coopération constante entre les acteurs·trices de la formation et de la recherche en didactique, à différents égards et par différents moyens ;
- le transfert et la circulation des savoirs entre les didactiques et l’école, la politique de l’éducation, le grand public, qui jouent un rôle particulier dans le champ ;
- l’intégration d’une multitude de cadres de référence méthodologiques et théoriques.
Le colloque s’est ouvert sur une rétrospective des réalisations permises par l’un des deux programmes de financement dont le projet 2Cr2D aura bénéficié entre 2017 et 2024. Il a permis aux participant·e·s de revenir sur l’expérience de ces 8 années, et sur les avancées des différents projets subventionnés dans la perspective de leur « portée politique significative pour l’ensemble des hautes écoles suisses ».
Au-delà de ce bilan, l’évènement a mis en lumière les défis et les avancées des didactiques disciplinaires, tout en soulignant l’importance de la recherche et de la collaboration interdisciplinaire pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage dans les salles de classe. L’implication des didacticien·nes dans autant d’« espaces intermédiaires » a été interprétée très positivement : de fait, cette multiplicité représente « une chance, notamment lorsque la mise en réseau est réussie et que des synergies se créent ».
Le 2Cr2D, représentant a la fois de la diversité et de l’unité romande à cet égard, a été bellement représenté dans ce 6e Colloque.
Parole à la relève
Diplômée MADD 2023 en didactique des mathématiques, actuellement doctorante et forte d’une expérience intercantonale, Isaline Rüf (UNIGE) a représenté la relève romande dans le cadre d’un panel entièrement alémanique par ailleurs, réunissant des représentant·es des diverses parties – Rectorats, corps professoral, étudiant·es. Merci encore à elle pour son excellente prestation et passionnante contribution !

« Il me semble qu’un aspect très important à développer est la collaboration. De par le 2Cr2D, la collaboration au niveau romand a été initiée (la formation du MADD réunit par exemple 6 institutions en Romandie).
Il me paraitrait intéressant de pouvoir élargir cette collaboration au niveau national, même si je suis consciente que cela n’est pas facile à instaurer en particulier en raison de la barrière linguistique.
Je pense toutefois qu’une telle collaboration représenterait une grande richesse, car la didactique des mathématiques, pour prendre l’exemple de mon domaine, présente des disparités. J’ai pu m’en rendre compte dans le cadre de ma participation aux évaluations CoFo / ÜGK où l’on a constaté que les contenus ne sont pas forcément les mêmes et/ou qu’ils ne sont pas enseignés de la même manière.
Ces différences seraient intéressantes à identifier, à discuter, à confronter… Il me semble qu’on en retirerait beaucoup et que cela permettrait des échanges précieux et des résultats intéressants. »
(c) swissuniversities / PH Thurgau
… et en anglais. Poster exposé dans le cadre du colloque
Retour sur deux contributions
L’intervention de Colin Cramer (Prof. Dr. À l’Université de Tübingen, Allemagne) a notamment soulevé la question de savoir si les didactiques disciplinaires (DD) sont des sciences en réseau et quelles sont leurs évolutions. Il a souligné l’importance des DD dans la formation des enseignants, tout en mettant en lumière les tensions entre les sciences de l’éducation et les domaines disciplinaires. Il a également abordé les objectifs à mettre en réseau et les relations internes/externes des DD, tout en reconnaissant la pluralité des définitions de ce domaine.
Sylvain Doussot (Prof. en Sciences de l’éducation, Inspé de Nantes Université) a également pris la parole le vendredi matin pour discuter des DD en tant que science au carrefour de la formation des enseignants et à l’analyse de leur travail. Doussot confronte les approches francophone, germanophone et anglo-saxonne et critique la démarche applicationniste traditionnelle au sein de l’approche française dans la formation des enseignant·e·s. Dans ce contexte, les élèves sont les exécutants d’une procédure car la théorie dominante repose pour l’apprentissage des compétences disciplinaires sur le calcul procédure + entrainement. Il regrette ce modèle idéologique inspiré selon lui du monde médical (« essai randomisé contrôlé »). Il a fortement souligné la distinction entre les savoirs à enseigner et les savoirs pour enseigner et se positionne pour une épistémologie de la pratique et une formulation didactique des compétences professionnelles pour la formation des enseignants.
Projets romands présentés
Parmi les membres de la communauté 2Cr2D, sont intervenu·es notamment :
- Sonya Florey, Roxane Gagnon, Solenn Petrucci
Circulation des savoirs ? Réflexion sur les enjeux définitoires et les conditions de réalisation de ce concept à partir d’une recension de travaux récents en didactique de français
- Sylvie Richard et Anne Clerc-Georgy (présidente de session)
Une didactique spécifique pour les premiers degrés de la scolarité ?
- Nadine Fink, Aurélie De Mestral
La circulation des savoirs et des pratiques de savoirs en contexte de formation à l’enseignement de l’histoire
- Diane Ruchet, Sandrine Bruttin
Se former en tant que didacticienne des APF
L’intervention de Diane Ruchet et Sandrine Bruttin (HEP Valais), également alumnae du Master, a donné à voir l’impact de leurs recherches de fin d’études sur leur enseignement actuel. Prenant en compte les choix politico-pédagogiques qui président aux développements de l’école romande, elles ont adressé les enjeux de consolidation spécifiques à la didactique des apprentissages fondamentaux. Une didactique encore émergente lors de la création du MADD. De fait, le Master a été conçu en réponse notamment aux besoins en qualification de la relève scientifique dans ce domaine.
- Anne-Sophie Gavin, Diane Hartmann, Marianne Milano, Thibaud Bauer
Le chocolat : une entrée pour la problématisation en sciences humaines et sociales ?
- Stéphane Clivaz, Valérie Batteau, Sara Presutti, Luc-Olivier Bünzli, Audrey Daina, Jean-Philippe Pellet
Connaissances mathématiques pour l’enseignement de la résolution de problèmes : construction dialogique lors d’une Lesson Study
- Olivier Bolomey
De l’allemand comme « tâche » à la « tâche actionnelle » pour apprendre l’allemand
- Myriam Garcia Perez
L’entrée à l’école et dans les disciplinaires scolaires à travers l’accompagnement du jeu de faire-semblant : Analyse de 5 classes romandes
- Thibaud Bauer, Marianne Milano, Alain Pache, Nadia Lausselet, Philippe Hertig
Quels enjeux pour former à la géographie les futur·es enseignant·es du secondaire 1 ?
- Sabine Chatelain, Karine Barman
L’évolution d’une formation intercantonale en didactique de la musique: apports d’une approche interdisciplinaire
- Antje Kolde, Catherine Fidanza, Stefano Losa, Raphael Brunner
Les didactiques « rares » en Suisse romande. La sociologie, les langues et cultures de l’Antiquité, l’histoire de l’art comme symptômes de nouvelles épistémologies et conceptions scientifiques.
Dans l’attente des Actes du colloque, nous vous invitons à consulter ceux de la dernière édition, qui font la part belle aux contributions romandes.